Jan Hus, Jan
Ziska et la révolte des Hussites
La Bohème au XIVe siècle
 La Bohème du 14e siècle, qui
correspond à peu près à la République Tchèque d'aujourd'hui,
est devenue très riche en un laps de temps relativement court grâce
aux mines d'argent. En particulier celles de Kuttenberg (Kutna
Hora), ouvertes en 1237, donnaient un résultat annuel de 100 000 Mark,
un Mark équivaut à une demi livre d'argent. Essentiellement ce
sont le roi et l'Eglise catholique qui en ont profité, et le
pape par des contributions de l'Eglise. Les membres des
corporations des villes minières devenaient également très
riches et se sont installé à Prague, laissant travailler
d'autres à leur compte. Prague s'est ainsi littéralement doré
et c'est ici que fut fondée en 1348 la première université du
Saint Empire. Sur la base des fortunes dégagées des mines
d'argent se développaient le commerce et la production des biens
d'utilisation courante, mais aussi des produits de luxe.
La Bohème du 14e siècle, qui
correspond à peu près à la République Tchèque d'aujourd'hui,
est devenue très riche en un laps de temps relativement court grâce
aux mines d'argent. En particulier celles de Kuttenberg (Kutna
Hora), ouvertes en 1237, donnaient un résultat annuel de 100 000 Mark,
un Mark équivaut à une demi livre d'argent. Essentiellement ce
sont le roi et l'Eglise catholique qui en ont profité, et le
pape par des contributions de l'Eglise. Les membres des
corporations des villes minières devenaient également très
riches et se sont installé à Prague, laissant travailler
d'autres à leur compte. Prague s'est ainsi littéralement doré
et c'est ici que fut fondée en 1348 la première université du
Saint Empire. Sur la base des fortunes dégagées des mines
d'argent se développaient le commerce et la production des biens
d'utilisation courante, mais aussi des produits de luxe.
Dans un état féodal,
ce développement devait forcément engendrer des conflits entre
marchands et artisans d'un côté et la noblesse privilégiée de
l'autre, entre les paysans qui voulaient s'affranchir du servage
et des propriétaires fonciers, puis entre les nobles et le
peuple face à l'Eglise catholique qui les exploitait tous.
Toutes les contradictions s'aggravèrent suite à une inflation
rapide dont bénéficiaient surtout les riches bourgeois des
villes, tandis que les paysans et les nobles sans grande fortune
en faisaient les frais. Ces contradictions sont en partie masquées
par un conflit national. Les rois Ottokar II et Charles I avaient
appelé beaucoup de paysans, d'artisans, d'artistes et de mineurs
allemands. A Kuttenberg, Deutschbrod et Iglau il n'y avait
pratiquement que des Allemands. L'université de Prague et les
hauts rangs de l'Eglise étaient entre leurs mains. Pour les tchèques,
ils apparaissaient soit comme des exploiteurs, soit comme des
concurrents. Inversement, les allemands avait un fort intérêt
à conserver le statu quo.
Jan Hus répand les théories
de Wyclif en Bohème et critique l'Eglise
Les choses
commencent à bouger sous l'influence des thèses de John Wyclif,
que Jérôme de Prague, né vers ![[Jan Hus]](Jan%20Hus%20I.jpg) 1365, avait apporté d'Angleterre vers 1400. Mais
c'est surtout Jan Hus (1369-1415), professeur tchèque de
l'université de Prague qui exprimait le mécontentement des tchèques
en s'appuyant justement sur les théories de John Wyclif. La réaction
de l'Eglise ne se faisait pas attendre : elle condamnait 45
enseignements de Wyclif comme hérésie. Mais la dispute
continuait et finalement le roi Vaclav fut obligé d'intervenir.
Il décréta en 1409 que les tchèques auraient désormais trois
voies et les allemands qu'une seule (avant c'était l'inverse). Là-dessus
la plupart des professeurs et des étudiants quittent Prague pour
s'installer à Leipzig. Par le dépa
1365, avait apporté d'Angleterre vers 1400. Mais
c'est surtout Jan Hus (1369-1415), professeur tchèque de
l'université de Prague qui exprimait le mécontentement des tchèques
en s'appuyant justement sur les théories de John Wyclif. La réaction
de l'Eglise ne se faisait pas attendre : elle condamnait 45
enseignements de Wyclif comme hérésie. Mais la dispute
continuait et finalement le roi Vaclav fut obligé d'intervenir.
Il décréta en 1409 que les tchèques auraient désormais trois
voies et les allemands qu'une seule (avant c'était l'inverse). Là-dessus
la plupart des professeurs et des étudiants quittent Prague pour
s'installer à Leipzig. Par le dépa rt des allemands la position de Hus était
renforcée, et sa lutte contre l'Eglise catholique plus sévère.
rt des allemands la position de Hus était
renforcée, et sa lutte contre l'Eglise catholique plus sévère.
Lorsque en 1412 le pape fût
à court d'argent il décida de lancer la vente des indulgences (une
sorte d'emprunt céleste sur des péchés futurs commis dans ce
monde-bas, autrement dit des bout de papier sans aucune valeur)
c'était le déclenchement de violents heurts entre Hussites tchèques
et catholiques allemands à Prague. A nouveau le roi Vaclav était
contraint d'intervenir : il expulsa de Prague Hus, mais
aussi quatre théologiens catholiques.
Le Concile
de Constance : Jan Hus est brûlé
En 1414 se réunit
à Constance un concile qui avait deux objectifs : élire un
nouveau pape (car il y en avait trois) et débattre du problème
de l'hérésie tchèque. Il y avait le risque d'une dissociation
du royaume de Bohème,  de
l'Eglise catholique et de l'empire allemand. L'empereur
Sigismund, frère de Vaclav et éventuellement son héritier,
devait à juste titre se faire quelques soucis. Il obtint que Hus
fut convoqué à Constance, sous la garantie d'un sauf-conduit.
Hus accepta ; confiant de la justesse de sa doctrine, à
savoir : la nécessité d'une vie modeste de quelque représentant
de l'Eglise que ce soit et la mise en cause de la légalité de
quelque seigneur que ce soit qui commet un péché mortel. Le
pape Jean XXIII, qui craint sa destitution, quitte le concile
dans l'espoir que celui-ci ne pourra pas continuer. Or, le
concile constate d'abord qu'il s'est réuni en règle, puis qu'il
détient son pouvoir de dieux. Ainsi il place son autorité au-dessus
du pape.
de
l'Eglise catholique et de l'empire allemand. L'empereur
Sigismund, frère de Vaclav et éventuellement son héritier,
devait à juste titre se faire quelques soucis. Il obtint que Hus
fut convoqué à Constance, sous la garantie d'un sauf-conduit.
Hus accepta ; confiant de la justesse de sa doctrine, à
savoir : la nécessité d'une vie modeste de quelque représentant
de l'Eglise que ce soit et la mise en cause de la légalité de
quelque seigneur que ce soit qui commet un péché mortel. Le
pape Jean XXIII, qui craint sa destitution, quitte le concile
dans l'espoir que celui-ci ne pourra pas continuer. Or, le
concile constate d'abord qu'il s'est réuni en règle, puis qu'il
détient son pouvoir de dieux. Ainsi il place son autorité au-dessus
du pape.
Après avoir
destitué les trois papes, les représentants des différents
pays (on vote par pays), les évêques et l'empereur Sigismund IV
débattent de la réforme de l'Eglise. Leur intérêt principal
est de diminuer le pouvoir papal ainsi que les versements à Rome
et de renforcer le contrôle des autorités nationales. En même
temps ils veulent limiter la réforme, car les effets des thèses
de Wyclif en Angleterre (les Lollards) sont connus.

Hus est invité
à présenter sa doctrine au début du concile quand le pouvoir
des anciens papes, en particulier de Jean XXIII, n'est pas encore
brisé. Malgré un sauf-conduit, délivré par Sigismund IV, il
est arrêté et mis au cachot pour le forcer à révoquer ses théories
considérées comme hérésie. En vain. Son procès commence en même
temps que le règlement de compte avec Jean XXIII. Bien que Hus
se défend bien (il demande une réfutation de ses thèses par la
bible), le concile n'entend pas céder un pas ni à droite (les
trois papes) ni à gauche. Il déclare les 45 thèses de Wyclif
comme hérétique. Puis il tente de prouver que Hus reprend ces
thèses hérétiques dans son livre « De Ecclesia ».
En conclusion Hus est déclaré hérétique et expulsé de
l'Eglise catholique (on lui coupe les cheveux) et livré à
l'autorité civile. La peine habituelle pour hérésie étant le
bûcher, Hus est brûlé le même jour, le 6 juillet 1415.
Jérôme de Prague
 Jérôme
de Prague était l'ami le plus proche de Jan Hus. Grand
humaniste, Jérôme était un voyageur infatiguable, allant
d'université en université, de ville en ville, jusqu'aux
confins de l'Europe (Il aurait même été à Jérusalem). C'est
par ses voyages qu'il aurait diffusé la doctrine de l'Anglais
Wiclyff, jusqu'a Prague.
Jérôme
de Prague était l'ami le plus proche de Jan Hus. Grand
humaniste, Jérôme était un voyageur infatiguable, allant
d'université en université, de ville en ville, jusqu'aux
confins de l'Europe (Il aurait même été à Jérusalem). C'est
par ses voyages qu'il aurait diffusé la doctrine de l'Anglais
Wiclyff, jusqu'a Prague.
En avril 1415 Jérôme de Prague va a Constance pour venir en
aide à Hus. Voyant le sort de Hus, qui était déjà emprisonné,
il prend la fuite. Malgré un sauf-conduit offert par le concile,
il ne vient pas. Il est arrêté en Bavière et ramené à
Constance. Sous la torture il abjure en Septembre 1415, mais il
n'est pas relâché pour autant. On lui fait finalement le procès
le 23 mai 1416 ou il défend les thèses de Wyclif et de Hus. Déclaré
hérétique il meurt le 30 mai 1416 sur le bûcher.
La révolte des
Hussites commence
Au lieu d'éteindre
le mouvement hussite, le Concile de Constance l'avait rallumé.
De plus en plus souvent il y eut des révoltes un peu partout en
Bohème. Le mouvement qui était en train de prendre forme fut
appelé d'après son symbole, le calice, les Calixtins. Le
calice était devenu le privilège des prêtres, le pain pour les
autres. Les Calixtins voulaient la liberté de choisir entre
cette nouvelle forme et l'ancienne (calice et pain pour tout le
monde). Bref, un symbole comme un autre, qui a surtout servi à
reconnaître les amis et à se regrouper. Les Calixtins ont
exprimé leurs revendications dans les quatre articles de
Prague :
1.
La communion dans les deux formes au choix (pain et calice)
2.
Tout péché publique ou mortel doit être puni sans regard
de la personne
3.
Confiscation des biens de l'Eglise
4.
Liberté de croyance
On peut
nettement distinguer deux partis dans le mouvement révolutionnaire :
d'un côté les modérés, les Utraquistes (utra, lat. =
égal, car il voulaient l'équivalence des deux formes de
communion), de l'autre, l'aile radical, les Taborites (d'après
la ville de Tabor qu'ils venaient de fonder).
Les partisans
des Calixtins étaient essentiellement les nobles qui avaient récupéré
les terres de l'Eglise et qui étaient donc très fortement liés
au mouvement hussite, puis les riches bourgeois qui s'étaient également
enrichis au dépens de l'Eglise et qui allaient plus tard
s'enrichir du butin de la guerre.
Les Taborites
![[Jan Zizka]](zizka.jpg) A l'opposé les paysans
et les artisans, qui ne voulaient pas simplement échanger un
seigneur par un autre mais la liberté entière. Ils étaient
fermement partisans des Taborites, et par conséquent les
Taborites représentaient la grande majorité et de loin.
A l'opposé les paysans
et les artisans, qui ne voulaient pas simplement échanger un
seigneur par un autre mais la liberté entière. Ils étaient
fermement partisans des Taborites, et par conséquent les
Taborites représentaient la grande majorité et de loin.
« En
ces temps il y aura sur terre ni roi ni seigneur ; ni sujet,
et tous les redevances et impôts seront abolis, aucun n'obligera
un autre à faire quelque chose car tous seront égaux ; frères
et soeurs. »
« Comme il n y pas de 'à moi' ni 'à toi', puisque tout
est à tous en commun, ainsi il en sera partout et celui qui aura
une propriété particulière commettra un péché mortel. »
Le roi Vaclav essayait de
naviguer entre les fronts jusqu'à ce que son frère Sigismund le
menace d'une invasion pour rétablir l'ordre. Mais lorsque Vaclav
rappelle finalement les théologiens catholiques qu'il avait
expulsé auparavant, c'est la révolte à Prague. Le 30. Juillet
1419 la ville s'est insurgée sous la direction d'un personnage
remarquable : Jan Zizka (1360-1424). C'est à
cette occasion qu'il y eut la première défenestration : on
jetait 7 membres du conseil de la ville de Prague par la fenêtre
pour les faire tomber dans des piques placées au bon endroit.
Lorsque le roi Vaclav apprit la nouvelle, il mourut sur le coup.
Désormais la Bohème était une République.
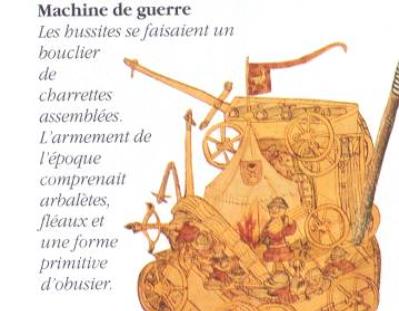
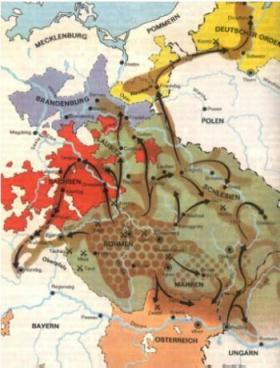
Les guerres
des Hussites
Les Utraquistes
de Prague tentèrent en secret des pourparlers avec l'empereur,
mais en vain à cause de l'attitude dure de Sigismund. Le pape
Martin V va même plus loin lorsqu'il appelle toute la chrétienté
à la croisade contre les Hussites. Cette première croisade, qui
eut lieu en 1420 se termine par une défaite des troupes
catholiques, battues par l'armée paysanne de Zizka. D'autres
« croisades » suivaient, à chaque fois plus désastreuses
pour l'empire. Si la guerre au début eut lieu en Bohème, elle
est maintenant portée en Silésie, en Prussie Orientale et
jusqu'à Gdansk à la mer Baltique, puis en Hesse et en Autriche.
Jan Zizka meurt en 1424, mais son successeur, André Prokop (1380-1434),
également un Taborite, continue la lutte. La quatrième « croisade »
en 1427 se termine prématurément à Mies, à l'entente des cris
de guerre des Hussites, de même que la cinquième en 1431 à
Taus. Il n'y avait plus personne qui osait affronter les
Hussites.
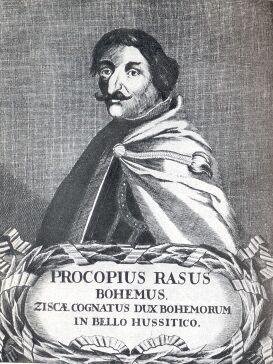
La fin des Hussites:
intrigues et trahisons
Dans cette
situation, l'empereur ne voyait plus qu'une seule issue :
diviser les Hussites. C'est pourquoi il entama des pourparlers
pour monter les Utraquistes contre les Taborites, c'est à dire
les nobles et les ric hes
bourgeois contre les paysans et les artisans. L'empereur et le
pape leur garantissaient « généreusement » le
butin, les terres et la fortune de l'Eglise. La noblesse tchèque
n'avait que très peu participé à la guerre, parce qu'elle
avait, déjà au début de la lutte, récupéré le butin
principal. De même les bourgeois des villes, qui eux avaient
certes profité de la guerre, mais cherchaient maintenant une
jouissance tranquille de leurs richesses. Si cela pouvait être
garanti par l'empereur et le pape lui-même, alors c'était
parfait. Il n'en demandaient pas plus. En 1433 on se mit d'accord
et la noblesse commençait aussitôt à recruter une armée pour
combattre les Taborites. La bataille eut lieu le 30 Mai 1434
à Lipany
: 25 000 mercenaires
de l'armée de la noblesse se battaient contre 18 000
Taborites. La bataille fut très longue car les deux camps
disposaient de forces comparables. Les nobles ont tout de même
remporté la victoire mais seulement à cause de la trahison de
la cavalerie taborite, qui quittait le champ de bataille. Sur les
18 000 Taborites, 13 000 ont été tués. Le
pouvoir des Taborites était brisé, mais pas anéanti.
hes
bourgeois contre les paysans et les artisans. L'empereur et le
pape leur garantissaient « généreusement » le
butin, les terres et la fortune de l'Eglise. La noblesse tchèque
n'avait que très peu participé à la guerre, parce qu'elle
avait, déjà au début de la lutte, récupéré le butin
principal. De même les bourgeois des villes, qui eux avaient
certes profité de la guerre, mais cherchaient maintenant une
jouissance tranquille de leurs richesses. Si cela pouvait être
garanti par l'empereur et le pape lui-même, alors c'était
parfait. Il n'en demandaient pas plus. En 1433 on se mit d'accord
et la noblesse commençait aussitôt à recruter une armée pour
combattre les Taborites. La bataille eut lieu le 30 Mai 1434
à Lipany
: 25 000 mercenaires
de l'armée de la noblesse se battaient contre 18 000
Taborites. La bataille fut très longue car les deux camps
disposaient de forces comparables. Les nobles ont tout de même
remporté la victoire mais seulement à cause de la trahison de
la cavalerie taborite, qui quittait le champ de bataille. Sur les
18 000 Taborites, 13 000 ont été tués. Le
pouvoir des Taborites était brisé, mais pas anéanti.
Georges de Podebrady :
le roi hussite
Cette victoire ouvrit la
voie du Trône à un hussite modéré : Georges de Podebrady

Après
avoir conquis la ville de Prague en 1448, il devint Lieutenant Général
du royaume en 1452. Après la mort du jeune roi Ladislas, il fût
élu roi en 1458. Premier roi élu dans l'histoire tchèque, non
issu d'une famille régnante, il fut aussi le seul roi hussite.
Il
a su unifier et pacifier la nation. A la tête d'une armée
puissante, il préférait toutefois gouverner par la diplomatie
et la raison.
Visionnaire,
il est l'auteur d'un projet d'union pan-européenne.
Après sa
mort, le Royaume passa finalement aux Habsbourg, par le jeu des
alliances et des mariages. Mais la noblesse tchèque jouira
encore d'une certaine autonomie, et l'Eglise Calixtaine a pu se
maintenir jusqu'au début du XVII ème siècle.
La Montagne Blanche
Les
dernières forces tchèques hussites furent définitivement
vaincues en 1620 à la bataille de la
Montagne Blanche . Survenue suite à la deuxième défenestration
de Prague (1618), lors de laquelle les emissaires des Habsbourg
furent jetés par les fenêtres du chateau de Prague, la Montagne
Blanche est la première bataille de la guerre de Trente Ans.
Elle opposa les seigneurs tchèques fidèles au hussisme ( 90 %
de la population tchèque était alors protestante - hussite-)
aux armées impériales des Habsbourgs, commandées par le fameux
généralissime Albrecht von Wallenstein.
La
défaite des hussites signifia la fin de l'indépendance tchèque
pour 300 ans, la victoire de la Contre-Réforme, l'éxécution de
27 grands seigneurs tchèques, et l'expulsion d'une grande partie
de la noblesse, mais aussi du petit peuple. Les derniers hussites
qui refusèrent la Contre-Réforme se fondirent peu à peu dans
les Eglises luthériennes.
C'est après la Montagne Blanche qu'un groupe d'émigrants tchèques
s'installa à Weyersheim.
 La Bohème du 14e siècle, qui
correspond à peu près à la République Tchèque d'aujourd'hui,
est devenue très riche en un laps de temps relativement court grâce
aux mines d'argent. En particulier celles de Kuttenberg (Kutna
Hora), ouvertes en 1237, donnaient un résultat annuel de 100 000 Mark,
un Mark équivaut à une demi livre d'argent. Essentiellement ce
sont le roi et l'Eglise catholique qui en ont profité, et le
pape par des contributions de l'Eglise. Les membres des
corporations des villes minières devenaient également très
riches et se sont installé à Prague, laissant travailler
d'autres à leur compte. Prague s'est ainsi littéralement doré
et c'est ici que fut fondée en 1348 la première université du
Saint Empire. Sur la base des fortunes dégagées des mines
d'argent se développaient le commerce et la production des biens
d'utilisation courante, mais aussi des produits de luxe.
La Bohème du 14e siècle, qui
correspond à peu près à la République Tchèque d'aujourd'hui,
est devenue très riche en un laps de temps relativement court grâce
aux mines d'argent. En particulier celles de Kuttenberg (Kutna
Hora), ouvertes en 1237, donnaient un résultat annuel de 100 000 Mark,
un Mark équivaut à une demi livre d'argent. Essentiellement ce
sont le roi et l'Eglise catholique qui en ont profité, et le
pape par des contributions de l'Eglise. Les membres des
corporations des villes minières devenaient également très
riches et se sont installé à Prague, laissant travailler
d'autres à leur compte. Prague s'est ainsi littéralement doré
et c'est ici que fut fondée en 1348 la première université du
Saint Empire. Sur la base des fortunes dégagées des mines
d'argent se développaient le commerce et la production des biens
d'utilisation courante, mais aussi des produits de luxe.![[Jan Hus]](Jan%20Hus%20I.jpg) 1365, avait apporté d'Angleterre vers 1400. Mais
c'est surtout Jan Hus (1369-1415), professeur tchèque de
l'université de Prague qui exprimait le mécontentement des tchèques
en s'appuyant justement sur les théories de John Wyclif. La réaction
de l'Eglise ne se faisait pas attendre : elle condamnait 45
enseignements de Wyclif comme hérésie. Mais la dispute
continuait et finalement le roi Vaclav fut obligé d'intervenir.
Il décréta en 1409 que les tchèques auraient désormais trois
voies et les allemands qu'une seule (avant c'était l'inverse). Là-dessus
la plupart des professeurs et des étudiants quittent Prague pour
s'installer à Leipzig. Par le dépa
1365, avait apporté d'Angleterre vers 1400. Mais
c'est surtout Jan Hus (1369-1415), professeur tchèque de
l'université de Prague qui exprimait le mécontentement des tchèques
en s'appuyant justement sur les théories de John Wyclif. La réaction
de l'Eglise ne se faisait pas attendre : elle condamnait 45
enseignements de Wyclif comme hérésie. Mais la dispute
continuait et finalement le roi Vaclav fut obligé d'intervenir.
Il décréta en 1409 que les tchèques auraient désormais trois
voies et les allemands qu'une seule (avant c'était l'inverse). Là-dessus
la plupart des professeurs et des étudiants quittent Prague pour
s'installer à Leipzig. Par le dépa rt des allemands la position de Hus était
renforcée, et sa lutte contre l'Eglise catholique plus sévère.
rt des allemands la position de Hus était
renforcée, et sa lutte contre l'Eglise catholique plus sévère.
 de
l'Eglise catholique et de l'empire allemand. L'empereur
Sigismund, frère de Vaclav et éventuellement son héritier,
devait à juste titre se faire quelques soucis. Il obtint que Hus
fut convoqué à Constance, sous la garantie d'un sauf-conduit.
Hus accepta ; confiant de la justesse de sa doctrine, à
savoir : la nécessité d'une vie modeste de quelque représentant
de l'Eglise que ce soit et la mise en cause de la légalité de
quelque seigneur que ce soit qui commet un péché mortel. Le
pape Jean XXIII, qui craint sa destitution, quitte le concile
dans l'espoir que celui-ci ne pourra pas continuer. Or, le
concile constate d'abord qu'il s'est réuni en règle, puis qu'il
détient son pouvoir de dieux. Ainsi il place son autorité au-dessus
du pape.
de
l'Eglise catholique et de l'empire allemand. L'empereur
Sigismund, frère de Vaclav et éventuellement son héritier,
devait à juste titre se faire quelques soucis. Il obtint que Hus
fut convoqué à Constance, sous la garantie d'un sauf-conduit.
Hus accepta ; confiant de la justesse de sa doctrine, à
savoir : la nécessité d'une vie modeste de quelque représentant
de l'Eglise que ce soit et la mise en cause de la légalité de
quelque seigneur que ce soit qui commet un péché mortel. Le
pape Jean XXIII, qui craint sa destitution, quitte le concile
dans l'espoir que celui-ci ne pourra pas continuer. Or, le
concile constate d'abord qu'il s'est réuni en règle, puis qu'il
détient son pouvoir de dieux. Ainsi il place son autorité au-dessus
du pape.
 Jérôme
de Prague était l'ami le plus proche de Jan Hus. Grand
humaniste, Jérôme était un voyageur infatiguable, allant
d'université en université, de ville en ville, jusqu'aux
confins de l'Europe (Il aurait même été à Jérusalem). C'est
par ses voyages qu'il aurait diffusé la doctrine de l'Anglais
Wiclyff, jusqu'a Prague.
Jérôme
de Prague était l'ami le plus proche de Jan Hus. Grand
humaniste, Jérôme était un voyageur infatiguable, allant
d'université en université, de ville en ville, jusqu'aux
confins de l'Europe (Il aurait même été à Jérusalem). C'est
par ses voyages qu'il aurait diffusé la doctrine de l'Anglais
Wiclyff, jusqu'a Prague. ![[Jan Zizka]](zizka.jpg) A l'opposé les paysans
et les artisans, qui ne voulaient pas simplement échanger un
seigneur par un autre mais la liberté entière. Ils étaient
fermement partisans des Taborites, et par conséquent les
Taborites représentaient la grande majorité et de loin.
A l'opposé les paysans
et les artisans, qui ne voulaient pas simplement échanger un
seigneur par un autre mais la liberté entière. Ils étaient
fermement partisans des Taborites, et par conséquent les
Taborites représentaient la grande majorité et de loin. 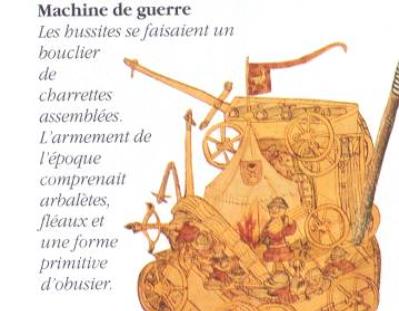
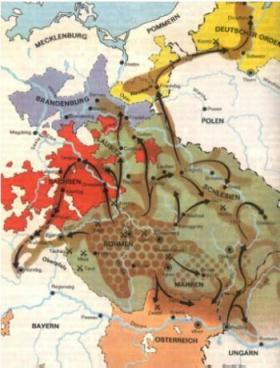
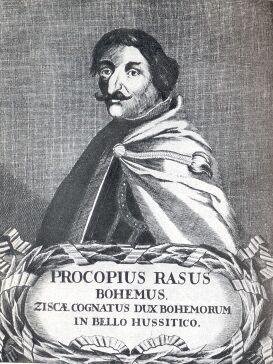
 hes
bourgeois contre les paysans et les artisans. L'empereur et le
pape leur garantissaient « généreusement » le
butin, les terres et la fortune de l'Eglise. La noblesse tchèque
n'avait que très peu participé à la guerre, parce qu'elle
avait, déjà au début de la lutte, récupéré le butin
principal. De même les bourgeois des villes, qui eux avaient
certes profité de la guerre, mais cherchaient maintenant une
jouissance tranquille de leurs richesses. Si cela pouvait être
garanti par l'empereur et le pape lui-même, alors c'était
parfait. Il n'en demandaient pas plus. En 1433 on se mit d'accord
et la noblesse commençait aussitôt à recruter une armée pour
combattre les Taborites. La bataille eut lieu le 30 Mai 1434
à
hes
bourgeois contre les paysans et les artisans. L'empereur et le
pape leur garantissaient « généreusement » le
butin, les terres et la fortune de l'Eglise. La noblesse tchèque
n'avait que très peu participé à la guerre, parce qu'elle
avait, déjà au début de la lutte, récupéré le butin
principal. De même les bourgeois des villes, qui eux avaient
certes profité de la guerre, mais cherchaient maintenant une
jouissance tranquille de leurs richesses. Si cela pouvait être
garanti par l'empereur et le pape lui-même, alors c'était
parfait. Il n'en demandaient pas plus. En 1433 on se mit d'accord
et la noblesse commençait aussitôt à recruter une armée pour
combattre les Taborites. La bataille eut lieu le 30 Mai 1434
à 