..... Le pain
blanc est un important produit d’appel car il
correspond à un besoin physiologique important : se
nourrir. Pendant des siècles, l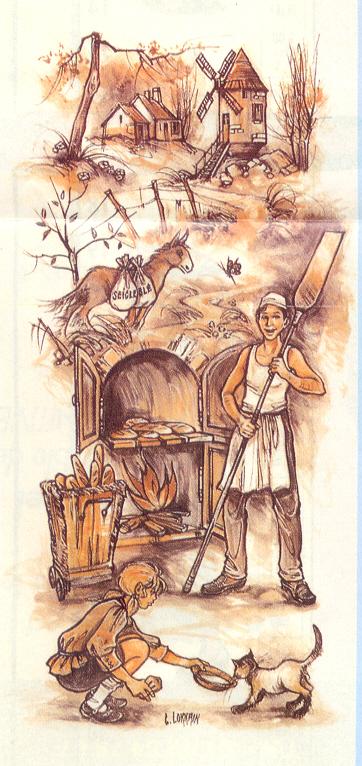 e pain a
été l’aliment de base de l’humanité. Véritable
trait d'union entre les peuples et les générations, il
a toujours eu une place de choix à table. e pain a
été l’aliment de base de l’humanité. Véritable
trait d'union entre les peuples et les générations, il
a toujours eu une place de choix à table.
Les Origines du Pain
..... L'origine du
pain se perd dans la nuit des temps car selon de récentes
recherches archéologiques, notre pain actuel serait l'héritier
d'une histoire vieille de plus de 5.000 ans.
..... Le premier
pain, qui paraît avoir pris naissance avec la
civilisation en Orient, a probablement été le résultat
de l'oubli d'une ménagère qui laissa un peu de cette
bouillie pendant un certain temps, dans un endroit abrité
du vent, avant de la faire cuire. Ce produit, qui resta
un aliment grossier et de digestion difficile, devint un
pain léger, gonflé et formé d'alvéoles d'air dès
qu'on lui rajouta un peu de levain.
.....  Au fil des
siècles, l'art boulanger s'est efforcé d'améliorer ce
produit afin de parvenir à un produit plus fin, plus léger,
plus digeste, meilleur au goût. Au fil des
siècles, l'art boulanger s'est efforcé d'améliorer ce
produit afin de parvenir à un produit plus fin, plus léger,
plus digeste, meilleur au goût.
..... Au gré des
migrations, l'art de fabriquer le pain s'est transmis
tout autour du bassin méditerranéen : en Egypte
ancienne, en Judée, en Asie mineure, en Grèce
puis à Rome et dans toute l'empire romain.
Le
Pain au Moyen-Âge : Talmeliers, Seigneurs et Abbayes
Les C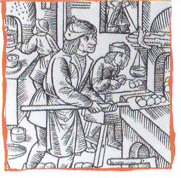 arolingiens
furent les premiers à réglementer la profession. Ainsi,
les missi dominici devaient s'assurer du bon
fonctionnement des fours, de la propreté des ustensiles
garnissant les boulangeries et engager les seigneurs à
en établir dans leurs domaines. arolingiens
furent les premiers à réglementer la profession. Ainsi,
les missi dominici devaient s'assurer du bon
fonctionnement des fours, de la propreté des ustensiles
garnissant les boulangeries et engager les seigneurs à
en établir dans leurs domaines.
..... Dans le
monde catholique du Moyen-Age, où les pèlerinages étaient
fréquents, les abbayes eurent un rôle favorable dans le
développement de la boulangerie.
Jusqu'à
la fin du XIIe siècle, seuls les rois et les seigneurs
avaient le droit de construire des fours. En fait, eux
seuls étaient pratiquement en capacité de couvrir les
frais de construction, d'assurer l'entretien et de lutter
efficacement contre les risques d'incendie. Les
utilisateurs de ces fours banaux -boulangers (appelés
alors talmeliers) et partic uliers - devaient payer le
droit de banalité au propriétaire. uliers - devaient payer le
droit de banalité au propriétaire.
C'est Philippe-Auguste qui permit aux boulangers de posséder
un four chez eux et Saint-Louis qui affranchit les villes
de la banalité des fours pour lutter contre les abus de
certains seigneurs.
Le pain représentait déjà l'aliment de base. Le
pouvoir royal réglementa sa fabrication et la profession
qui le produisait afin d'éviter les fraudes sur la
qualité de la farine, sur les poids et sur les prix et
pour qu'en tout état de cause (surtout en période de
disette) le pain ne manque pas.
C'est ainsi que Louis XI rendit une ordonnance sévère
pour protéger les voitures de blé. En 1539, François 1er
leur accorda la sauvegarde royale et, en 1635, il fut
interdit aux soldats, sous peine de mort, de se livrer au
pillage des grains circulant sur les rivières.
Les
Corporations : Organisation et Règlementation de la
profession
Etienne
Boileau, prévôt de Paris sous Saint-Louis, rédigea le
Livre des Métiers. Cet ouvrage constitua une véritable
charte des métiers et fut à la base de l'organisation
des corporations.
Les professionnels furent répartis en apprentis, valets
et maîtres. Comme leurs noms l'indiquent, les apprentis
apprenaient le métier, les valets l'exerçaient et les
maîtres dirigeaient et étaient pro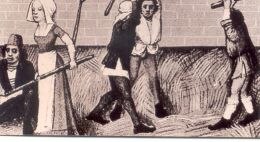 priétaires
d'une boulangerie. Pour être boulanger, il fallait posséder
le brevet de maîtrise, acheter le métier au roi ou au
seigneur et payer annuellement le droit de hauban. Il y
avait quatre catégories de boulangers : les
boulangers de petits pains qui avaient le droit de
fabriquer toutes les sortes e pains y compris les petits
pains ; les boulangers de gros pains ou boulangers des
faubourgs : ils ne pouvaient pas vendre de petits pains
et étaient situés dans les bourgs intégrés à la
ville proprement dite, lors de son extension ; les
boulangers forains étaient étrangers à la localité et
n'avaient le droit de vendre leurs pains en ville que le
samedi, jour de marché ; enfin, les boulangers privilégiés
étaient attachés au service du roi. priétaires
d'une boulangerie. Pour être boulanger, il fallait posséder
le brevet de maîtrise, acheter le métier au roi ou au
seigneur et payer annuellement le droit de hauban. Il y
avait quatre catégories de boulangers : les
boulangers de petits pains qui avaient le droit de
fabriquer toutes les sortes e pains y compris les petits
pains ; les boulangers de gros pains ou boulangers des
faubourgs : ils ne pouvaient pas vendre de petits pains
et étaient situés dans les bourgs intégrés à la
ville proprement dite, lors de son extension ; les
boulangers forains étaient étrangers à la localité et
n'avaient le droit de vendre leurs pains en ville que le
samedi, jour de marché ; enfin, les boulangers privilégiés
étaient attachés au service du roi.
La corporation se trouvait placée sous l'autorité du
Grand Panetier, nommé par le roi et assisté par le Maître
des boulangers et douze jurés chargés de veiller à
l'exécution des règlements de la profession.
En raison de la rudesse de leur métier, les boulangers bénéficiaient
à cette époque de privilèges : exemption du guet ou du
service militaire. Ils étaient en revanche très contrôlés
et lourdement pénalisés en cas de fraude sur le poids
ou la qualité de leurs produits. La vente de pain
corrompu, par exemple, entraînait une amende de 500 livres
; la boulangerie pouvait être fermée pendant six mois
et le four démoli. Le professionnel pouvait encourir des
peines corporelles sur la place publique (carcan, etc.).
Parfois même, ils avaient à répondre devant la justice
populaire, le peuple rendant souvent le boulanger
responsable de la cherté ou du manque de pain.
Faut-il rappeler que les premier troubles du 28 avril 1789
qui devaient déclencher la Révolution française, trouvèrent
leur origine dans le manque de pain ? Et le 5 octobre 1789,
les parisiennes ayant en vain réclamé du pain devant
l'Hôtel de Ville, marchèrent sur Versailles pour
ramener à Paris " le boulanger, la boulangère
et le mitron ".
Si la Révolution française a entraîné la suppression
des corporations et proclamé la liberté du commerce et
de l'industrie, ce fut pour u ne courte
durée car une réglementation soumettant l'exercice de
la profession de boulanger à l'autorisation du préfet
fut prise dès le Consulat et resta en vigueur jusqu'au décret
du 22 juin 1863 qui, à nouveau, accorda une
liberté relative au commerce. Jusque là, les boulangers
étaient obligés de constituer des réserves pour éviter
les disettes et la cherté du pain. Le nombre de
boulangers se trouvait limité. Une caisse de service de
la boulangerie parisienne fut créée pour, en quelque
sorte, " subventionner " le prix du
pain. Ce prix fut ensuite taxé. Un décret de 1863
supprima ces obligations, mais une taxe officieuse se
substitué à la taxe officielle. Pour finir, le prix du
pain resta taxé jusqu'en 1960. ne courte
durée car une réglementation soumettant l'exercice de
la profession de boulanger à l'autorisation du préfet
fut prise dès le Consulat et resta en vigueur jusqu'au décret
du 22 juin 1863 qui, à nouveau, accorda une
liberté relative au commerce. Jusque là, les boulangers
étaient obligés de constituer des réserves pour éviter
les disettes et la cherté du pain. Le nombre de
boulangers se trouvait limité. Une caisse de service de
la boulangerie parisienne fut créée pour, en quelque
sorte, " subventionner " le prix du
pain. Ce prix fut ensuite taxé. Un décret de 1863
supprima ces obligations, mais une taxe officieuse se
substitué à la taxe officielle. Pour finir, le prix du
pain resta taxé jusqu'en 1960.
..... En France,
le pain s'est affirmé comme la nourriture de base jusqu'à
la veille du vingtième siècle.
A
l’époque « moderne », il a été accusé
injustement de tous les maux par la mode et par certains
médecin (faire grossir, et même favoriser la formation
de cancers !), ce qui eut pour conséquence de faire
chuter la consommation (les « mauvais »
artisans ayant également leur part de responsabilité).
Heureusement, le bon sens semble revenir, la consommation
arrêtant sa chute et augmentant même légèrement.
|
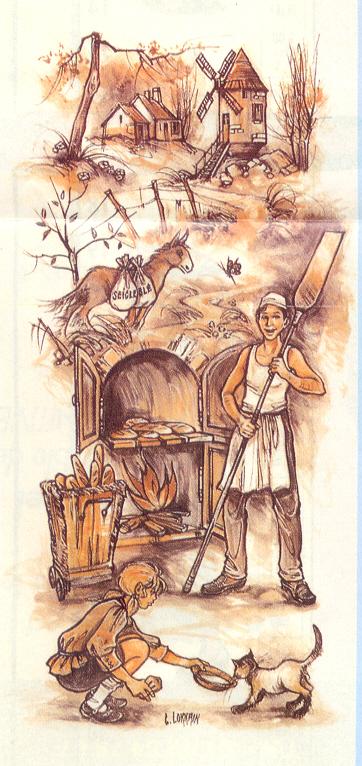 e pain a
été l’aliment de base de l’humanité. Véritable
trait d'union entre les peuples et les générations, il
a toujours eu une place de choix à table.
e pain a
été l’aliment de base de l’humanité. Véritable
trait d'union entre les peuples et les générations, il
a toujours eu une place de choix à table. Au fil des
siècles, l'art boulanger s'est efforcé d'améliorer ce
produit afin de parvenir à un produit plus fin, plus léger,
plus digeste, meilleur au goût.
Au fil des
siècles, l'art boulanger s'est efforcé d'améliorer ce
produit afin de parvenir à un produit plus fin, plus léger,
plus digeste, meilleur au goût. 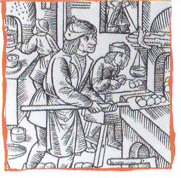 arolingiens
furent les premiers à réglementer la profession. Ainsi,
les missi dominici devaient s'assurer du bon
fonctionnement des fours, de la propreté des ustensiles
garnissant les boulangeries et engager les seigneurs à
en établir dans leurs domaines.
arolingiens
furent les premiers à réglementer la profession. Ainsi,
les missi dominici devaient s'assurer du bon
fonctionnement des fours, de la propreté des ustensiles
garnissant les boulangeries et engager les seigneurs à
en établir dans leurs domaines.  uliers - devaient payer le
droit de banalité au propriétaire.
uliers - devaient payer le
droit de banalité au propriétaire. 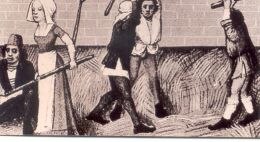 priétaires
d'une boulangerie. Pour être boulanger, il fallait posséder
le brevet de maîtrise, acheter le métier au roi ou au
seigneur et payer annuellement le droit de hauban. Il y
avait quatre catégories de boulangers : les
boulangers de petits pains qui avaient le droit de
fabriquer toutes les sortes e pains y compris les petits
pains ; les boulangers de gros pains ou boulangers des
faubourgs : ils ne pouvaient pas vendre de petits pains
et étaient situés dans les bourgs intégrés à la
ville proprement dite, lors de son extension ; les
boulangers forains étaient étrangers à la localité et
n'avaient le droit de vendre leurs pains en ville que le
samedi, jour de marché ; enfin, les boulangers privilégiés
étaient attachés au service du roi.
priétaires
d'une boulangerie. Pour être boulanger, il fallait posséder
le brevet de maîtrise, acheter le métier au roi ou au
seigneur et payer annuellement le droit de hauban. Il y
avait quatre catégories de boulangers : les
boulangers de petits pains qui avaient le droit de
fabriquer toutes les sortes e pains y compris les petits
pains ; les boulangers de gros pains ou boulangers des
faubourgs : ils ne pouvaient pas vendre de petits pains
et étaient situés dans les bourgs intégrés à la
ville proprement dite, lors de son extension ; les
boulangers forains étaient étrangers à la localité et
n'avaient le droit de vendre leurs pains en ville que le
samedi, jour de marché ; enfin, les boulangers privilégiés
étaient attachés au service du roi.  ne courte
durée car une réglementation soumettant l'exercice de
la profession de boulanger à l'autorisation du préfet
fut prise dès le Consulat et resta en vigueur jusqu'au décret
du 22 juin 1863 qui, à nouveau, accorda une
liberté relative au commerce. Jusque là, les boulangers
étaient obligés de constituer des réserves pour éviter
les disettes et la cherté du pain. Le nombre de
boulangers se trouvait limité. Une caisse de service de
la boulangerie parisienne fut créée pour, en quelque
sorte, " subventionner " le prix du
pain. Ce prix fut ensuite taxé. Un décret de 1863
supprima ces obligations, mais une taxe officieuse se
substitué à la taxe officielle. Pour finir, le prix du
pain resta taxé jusqu'en 1960.
ne courte
durée car une réglementation soumettant l'exercice de
la profession de boulanger à l'autorisation du préfet
fut prise dès le Consulat et resta en vigueur jusqu'au décret
du 22 juin 1863 qui, à nouveau, accorda une
liberté relative au commerce. Jusque là, les boulangers
étaient obligés de constituer des réserves pour éviter
les disettes et la cherté du pain. Le nombre de
boulangers se trouvait limité. Une caisse de service de
la boulangerie parisienne fut créée pour, en quelque
sorte, " subventionner " le prix du
pain. Ce prix fut ensuite taxé. Un décret de 1863
supprima ces obligations, mais une taxe officieuse se
substitué à la taxe officielle. Pour finir, le prix du
pain resta taxé jusqu'en 1960.